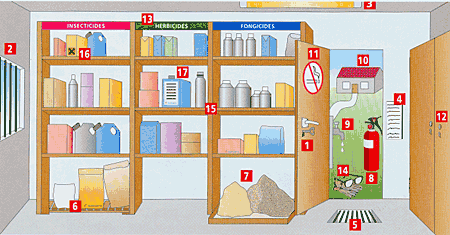L’eau, même douce, contient des sels dissous, en quantité plus ou moins importante. L’irrigation, année après année, par une eau même très légèrement salée, va augmenter la quantité de sels dans le sol : l’eau est en effet absorbée par les plantes, ou s’évapore, mais le sel, qui ne traverse pas la barrière racinaire, est retenu dans le sol. Le phénomène est accéléré et amplifié lorsque cette eau est plus chargée en sels. Or l’augmentation de la teneur en sel des sols entraîne à terme une toxicité pour les végétaux, ainsi qu’une dégradation des sols. En parallèle, l’eau devient de moins en moins facilement absorbable par les plantes, qui doivent consacrer une énergie croissante pour l’extraire du sol. Ainsi les conditions de forte salinité provoquent une sécheresse physiologique et un flétrissement des végétaux, car les racines ne sont plus capables d’extraire suffisamment d’eau du sol, alors que le sol peut sembler encore très humide !
+ d’infos sur les sols salés : ici
+ d’infos sur les sols salés : ici
Zones concernées
Ces phénomènes sont encore plus marqués dans les zones semi arides ou arides, plus exigeantes en irrigation : les quantités de sels accumulées sont directement liées aux doses totales d’irrigation. Ces sels dissous sont essentiellement des ions sodium (Na+), dont l’accumulation va entraîner progressivement la formation de sols sodiques, très peu fertiles. D’après la FAO, la salinisation des sols due à l’irrigation réduit la surface des terres irriguées de 1 à 2 % par an. Les terres semi arides et arides sont les plus touchées (presque un quart d’entre elles). L’Afrique du Nord, le Moyen Orient et l’Inde sont de plus en plus menacées. Si la France n’est pas touchée à grande échelle par ce phénomène, la question de la possibilité d’irriguer avec des eaux salées se pose dans certaines situations littorales, où l'infiltration d'eau de mer induit un risque important de salinité de l'eau d'irrigation, aggravé en cas de sécheresse.
Critères de qualité des eaux d’irrigation
Cinq critères permettent d’apprécier la qualité de l’eau d’irrigation. Ils sont applicables à toutes les cultures :
- Salinité : contenu total en sels solubles, apprécié par la conductivité électrique
- Sodium : proportion relative des cations sodium (Na+) par rapport au calcium et magnésium, appréciée par le SAR1 (sodium adsorption ratio)
- Alcalinité et Dureté : concentration en carbonate (CO32-) et en bicarbonate (HCO3-), en relation avec la concentration en calcium (Ca2+) et en magnésium (Mg2+)
- Concentration en éléments toxiques : sodium, chlore, bore par exemple
- pH de l’eau d’irrigation
Salinité Les principaux sels responsables de la salinité de l’eau sont le calcium, le magnésium, le sodium, les chlorures, les sulfates et les bicarbonates. Une valeur élevée de la salinité traduit une quantité importante d’ions en solution et rend plus difficile l’absorption de l’eau et des éléments minéraux par la plante. Une salinité trop élevée peut causer des brûlures racinaires.
La salinité est souvent évaluée par la mesure de la conductivité électrique (CE), exprimée en mS/cm. 1 mS/cm correspond en moyenne à 640 ppm de sels.
En dessous de 0,70 mS/cm, le rendement des cultures annuelles n’est généralement pas affecté par la salinité. Entre 0,70 et 3,0 mS/cm, le maintien des rendements nécessite des façons culturales adéquates. Par exemple on peut être amené à augmenter la dose d’irrigation en l’associant à du drainage, gypsage…).
Dans le cas particulier des gazons, une CE de 0,75 mS/cm est la limite approximative pour la croissance, sans avoir à mettre en place des interventions en relation avec la salinité.
La salinité est souvent évaluée par la mesure de la conductivité électrique (CE), exprimée en mS/cm. 1 mS/cm correspond en moyenne à 640 ppm de sels.
En dessous de 0,70 mS/cm, le rendement des cultures annuelles n’est généralement pas affecté par la salinité. Entre 0,70 et 3,0 mS/cm, le maintien des rendements nécessite des façons culturales adéquates. Par exemple on peut être amené à augmenter la dose d’irrigation en l’associant à du drainage, gypsage…).
Dans le cas particulier des gazons, une CE de 0,75 mS/cm est la limite approximative pour la croissance, sans avoir à mettre en place des interventions en relation avec la salinité.
- Sous 0,40 mS/cm, la croissance de la plupart des gazons est bonne.
- Entre 0,25 et 0,75 mS/cm, l’eau peut être utilisée sur les sols présentant un bon drainage et pour les gazons peu sensibles à la salinité (comme la fétuque élevée).
- Entre 0,75 et 2,25 mS/cm, l’eau ne devrait pas être utilisée dans les sols peu drainants. Cette eau ne peut pas être utilisée pour l’irrigation des végétaux sensibles au sel (comme le pâturin des prés ou la fétuque rouge), même sur les sols présentant un bon drainage.
- Au delà de 2,25 mS/cm, l’eau ne doit pas être utilisée en irrigation des gazons.
Sodium et SAR
Le sodium a un impact négatif sur la perméabilité du sol et sur l’infiltration de l’eau. Il remplace le calcium et le magnésium adsorbés sur les feuillets d’argile et provoque la dispersion des particules du sol. Les conséquences observées sont la déstructuration des sols argileux, qui deviennent compacts et risquent une prise en masse, et la réduction de leur perméabilité à l’origine de risques d’asphyxie racinaire. La perméabilité des sols sableux peut ne pas se détériorer aussi vite que celle des sols plus lourds lorsqu’ils sont irrigués avec une eau de forte teneur en sodium, mais un risque potentiel existe.
Mais l’effet du sodium d’une eau d’irrigation dépend aussi de la concentration en calcium et magnésium de celle-ci. Le SAR permet de tenir compte des effets mutuels du sodium, du calcium et du magnésium.
SAR = Na / √((Ca + Mg)/2)
Le sodium a un impact négatif sur la perméabilité du sol et sur l’infiltration de l’eau. Il remplace le calcium et le magnésium adsorbés sur les feuillets d’argile et provoque la dispersion des particules du sol. Les conséquences observées sont la déstructuration des sols argileux, qui deviennent compacts et risquent une prise en masse, et la réduction de leur perméabilité à l’origine de risques d’asphyxie racinaire. La perméabilité des sols sableux peut ne pas se détériorer aussi vite que celle des sols plus lourds lorsqu’ils sont irrigués avec une eau de forte teneur en sodium, mais un risque potentiel existe.
Mais l’effet du sodium d’une eau d’irrigation dépend aussi de la concentration en calcium et magnésium de celle-ci. Le SAR permet de tenir compte des effets mutuels du sodium, du calcium et du magnésium.
SAR = Na / √((Ca + Mg)/2)
Les éléments doivent être exprimés dans la même unité (meq/L en général).
- Lorsque le SAR est inférieur à 10, l’eau peut être utilisée pratiquement sur tout type de sol, sans risque notable d’accumulation du sodium à un niveau dommageable.
- Entre 10 et 18, les risques d’accumulation de sodium et de dommages sont réels pour les sols de texture fine et de capacité d’échange cationique (CEC) élevée. Mais l’eau peut être utilisée dans les sols sableux bien drainants.
- Entre 18 et 26, l’utilisation de l’eau peut aboutir à des niveaux dommageables de sodium dans pratiquement tous les types de sols. Les interventions telles que le gypsage et le drainage peuvent être nécessaires pour échanger les ions sodium.
- Lorsque le SAR est supérieur à 26, l’eau est généralement inadéquate pour l’irrigation.
Alcalinité et dureté Dans la plupart des cas, les carbonates sont présents dans les eaux sous forme de bicarbonates HCO3- en équilibre électrique avec des charges positives : calcium ou magnésium.
Ces ions, au contact de l’atmosphère chargée en CO2 et en présence de calcium, précipitent sous forme de carbonates calciques CaCO3. Ils peuvent ainsi provoquer le colmatage des circuits d’arrosage par entartrage.
Ces ions, au contact de l’atmosphère chargée en CO2 et en présence de calcium, précipitent sous forme de carbonates calciques CaCO3. Ils peuvent ainsi provoquer le colmatage des circuits d’arrosage par entartrage.
Concentration en éléments toxiques
Certains sels peuvent être gênants quand ils se trouvent naturellement en quantités supérieures aux exportations classiques des végétaux.
Le chlore par exemple n’est indispensable à la plante qu’en quantités infinitésimales. Il est rarement utile. Certaines plantes sont tolérantes au chlore comme la betterave à sucre, la tomate, l’orge, l’épinard. Par contre d’autres plantes sont sensibles à sa présence comme la plupart des arbres fruitiers ; le tabac, la pomme de terre, la laitue les haricots.
Globalement pour la plupart des espèces la teneur des chlorures dans l’eau ne doit pas dépasser 250 mg/l. Elle devra être inférieure à 35 mg/l pour des plantes sensibles telles que le tabac, les fougères, les azalées…
Certains sels peuvent être gênants quand ils se trouvent naturellement en quantités supérieures aux exportations classiques des végétaux.
Le chlore par exemple n’est indispensable à la plante qu’en quantités infinitésimales. Il est rarement utile. Certaines plantes sont tolérantes au chlore comme la betterave à sucre, la tomate, l’orge, l’épinard. Par contre d’autres plantes sont sensibles à sa présence comme la plupart des arbres fruitiers ; le tabac, la pomme de terre, la laitue les haricots.
Globalement pour la plupart des espèces la teneur des chlorures dans l’eau ne doit pas dépasser 250 mg/l. Elle devra être inférieure à 35 mg/l pour des plantes sensibles telles que le tabac, les fougères, les azalées…
Pilotage délicat de l’irrigationPlus encore qu’avec des eaux douces, la gestion de l’irrigation avec des eaux salées devra tenir compte des caractéristiques du milieu. Si l’évaporation est importante, il faut éviter un trop faible apport en eau, car celle-ci serait évaporée avant d’avoir pu irriguer complètement les plantes et le sol : les sels dissous s’accumuleraient dans les premiers horizons. A l’inverse, dans les situations où l’eau s’infiltre lentement et s’accumule en profondeur, on peut observer une remontée des eaux souterraines par capillarité. Cette action capillaire ramène vers la surface les sels dissous situés en profondeur. Un phénomène comparable peut être observé avec les remontées de nappes souterraines d’eau saumâtre. Les apports en eau pour l’irrigation doivent donc être calculés en fonction des taux d’évaporation, de la proximité et de la qualité des eaux souterraines, et de la teneur en sels du sol et de l’eau.