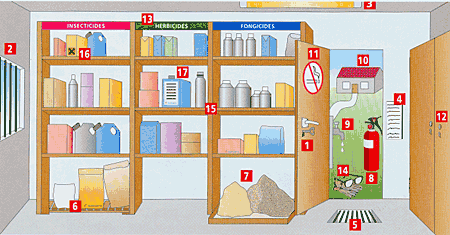La septoriose progresse à la faveur des pluies d’avril et mai

La septoriose est l’un des principaux bioagresseurs du blé fortement préjudiciable. Cette maladie causée par l’agent pathogène Mycosphaerella graminicola (anamorph Septoria tritici) peut entraîner d’importantes pertes de rendement. Sa nuisibilité moyenne interannuelle est de 17 q/ha mais les dégâts peuvent s’élever jusqu’à 50 % dans les situations les plus exposées.
La septoriose se reconnaît grâce aux taches présentes sur le feuillage. Elles peuvent être blanches et allongées ou brunes, de formes ovales ou rectangulaires. Au sein de ces taches, des pycnides noires (petits points noirs très visibles) sont présents et caractéristiques de la maladie.
Un champignon qui se propage via les éclaboussures de pluie
A la faveur de l’humidité ambiante ou de pluies, les pycnides se gorgent d’eau, gonflent, et les spores sont expulsées sous forme de gelée sporifère transparente appelée « cirrhe ». Celles-ci sont alors disséminées vers les feuilles supérieures via les éclaboussures de pluie. La progression de la maladie se fait donc de la base vers le haut de la plante, les pluies sont le moteur de l’épidémie.
La variété est le premier moyen de lutte agronomique pour maîtriser la septoriose
Différentes méthodes de lutte peuvent être mises en œuvre pour limiter les contaminations deSeptoria tritici. Le choix variétal constitue le levier le plus efficace de la lutte agronomique. Le choix d’une variété tolérante à la septoriose permet d’abaisser la pression parasitaire et donc la nuisibilité Cependant, l’efficacité n’est que partielle et la variété résistante à toutes les maladies n’existe pas !
Figure n°1 : Niveau de résistance des variétés de blé tendre à la septoriose
Cliquer sur l'image pour l'agrandir
D’autres facteurs agronomiques influencent secondairement la pression parasitaire et peuvent être utilisés en combinaison du choix variétal. Le choix de la date de semis pèse également dans la gestion du risque septoriose. Ainsi, des blés semés tardivement sont en général moins touchés car ils échappent aux premières contaminations par voie ascosporée. L’inoculum est alors moins important en sortie d’hiver. Eviter les semis trop précoces (fin septembre) permet de limiter le développement de la septoriose, tout en préservant la productivité.
Pour la septoriose, les densités élevées sont associées à une plus forte pression de la maladie mais leur effet reste irrégulier. À l'inverse, les très faibles densités peuvent limiter la pression de maladie, mais aussi affecter le rendement. Un compromis est à trouver et a minima les densités excessives sont à éviter.
Enfin, d’une manière générale la succession blé sur blé et la présence de résidus en surface pourrait favoriser la maladie. Toutefois, à la différence du piétin-verse, la septoriose n’est pas une maladie à caractère parcellaire et pour laquelle l’inoculum initial pourrait être limitant.
La période de prise en compte de la septoriose démarre au stade 2 noeuds
A partir du stade 2 noeuds, observer la F2 du moment (F4 définitive) sur une vingtaine de plantes, en ne comptant que les feuilles déployées. A partir du stade dernière feuille pointante, observer la F3 déployée du moment (F4 définitive).
- Pour les variétés sensibles (notes 4 à 6): si plus de 20% des feuilles observées présentent des taches de septoriose, réaliser un traitement avant les prochaines pluies.
- Pour les variétés peu sensibles (notes 7) : le seuil de feuilles atteintes est modifié à 50%.
Figure n°2 : Seuils d'intervention de la septoriose pour le blé tendre